 En gare de Saint-Avold, le 1er septembre 1939.
En gare de Saint-Avold, le 1er septembre 1939.
L’évacuation de Saint-Avold
Le séjour dans la Vienne d’une partie importante de la population évacuée de Saint-Avold (septembre 1939 - septembre 1940)
Extraits de l’article de Nicolas Provot paru dans le “Cahier Naborien” n° 2
Dès 1937 avait été élaboré un plan qui prévoyait, dans le cas où un conflit avec l’Allemagne hitlérienne deviendrait imminent, l’évacuation des localités situées dans la “zone rouge” ou encore “zone avant”. Cette zone comprenait la bande du territoire français coincée entre la ligne Maginot et la frontière franco-allemande.
L’invasion par les armées du Troisième Reich de la Pologne, à laquelle la France et la Grande-Bretagne étaient alliées, rendit la guerre inévitable. Aussi, le jour même de cette invasion, le vendredi 1er septembre 1939, au milieu de l’après-midi, les autorités préfectorales firent parvenir dans les mairies de la “zone rouge” l’ordre d’évacuation exécutoire le jour même et le lendemain samedi.
Ce fut le signal du plus vaste flot migratoire que le département de la Moselle ait connu au cours de l’histoire. Partageant le sort de 200 000 Mosellans, dont la totalité des habitants du canton de Saint-Avold, les Naboriens se trouvèrent brutalement arrachés à leur cité, jetés sur la route de l’inconnu et dispersés à travers la France.
La fraction la plus importante de la diaspora naborienne - environ 2 500 personnes - fut accueillie, de septembre 1939 à septembre 1940, dans le département de la Vienne, chef-lieu Poitiers. Cet accueil se déroula - vu les circonstances - de façon satisfaisante dans dix-huit localités auxquelles il faut ajouter Poitiers.
Un accueil bien préparé
Sitôt débarqués du train en gare de Couhé, les Naboriens sont invités à prendre place dans des voitures particulières, des camionnettes ou des charrettes attelées, pour être acheminés vers les différentes localités d’accueil. À leur arrivée dans celles-ci, ils sont regroupés à proximité de la mairie où le Comité d’accueil local procède à une double opération :
- recensement des réfugiés (composition de la famille, profession…).
- affectation à une famille poitevine en fonction de ses possibilités d’accueil (locaux, lits…). Cette opération, menée avec le double souci de “ne pas séparer les membres d’une même famille” et “d’adapter dans la mesure du possible les réfugiés aux hébergeants en fonction de leurs professions” fut parfois délicate et laborieuse. Après ces formalités, les réfugiés étaient dirigés avec leurs maigres bagages vers les familles d’accueil où eurent lieu les premiers contacts généralement empreints de cordialité. Donc, en ce qui concerne tout au moins les Naboriens arrivés en gare de Couhé, tout le monde, à de rares exceptions près, trouva un lit et un repas chaud.
Les Naboriens furent répartis dans huit communes du canton de Gençay et dix communes du canton de Couhé-Vérac, les habitants de Dourd’hal rejoignant Usson-du Poitou. L’aire géographique à l’intérieur de laquelle se trouvent les localités d’accueil est située au Sud de Poitiers.
C’est un secteur exclusivement agricole à la terre fertile, davantage orienté vers la polyculture - le blé dominait toutefois - que vers l’élevage, du fait de l’absence de prairies naturelles. Le climat est soumis à l’influence océanique : La Rochelle est à une centaine de kilomètres à vol d’oiseau. Cela changea nos Naboriens habitués à la terre sablonneuse de la pointe gréseuse du Warndt et au climat plus rude des Marches de l’Est.
Ce qui frappait tout d’abord, c’était l’importance de la population des communes d’accueil. Sur les dix-huit localités, douze approchaient ou dépassaient le millier d’habitants. Seules trois d’entre elles comptaient moins de 500 âmes, alors que les villages agricoles du canton de Saint-Avold comptaient tous en 1936 moins de 500 habitants. Mais comme nous nous trouvions dans une région à l’habitat dispersé, une grande partie, parfois les 2/3, de la population était disséminée dans une constellation de fermes champêtres, écarts, hameaux, de sorte que le noyau de la localité, groupé autour de l’église, de l’école et de la mairie ne représentait qu’une partie des habitants.
La localité la plus peuplée et qui accueillit le plus grand nombre de réfugiés était Couhé-Vérac, chef-lieu de l’un des cantons. Le bourg s’étire sur plusieurs kilomètres depuis le pont de Valence jusqu’aux dernières maisons de l’avenue de Bordeaux, le long de la Nationale 10. De part et d’autre de cet axe de circulation important, partent, en se ramifiant, une foule de ruelles étroites. Outre un nombre somme toute élevé de commerces, d’échoppes d’artisans ainsi que tous les services que l’on trouvait habituellement dans un chef-lieu de canton, ce qui faisait surtout la réputation du bourg, c’étaient son marché hebdomadaire et ses foires. Le marché aux volailles, lapins, fruits, légumes, pâtisserie, etc… occupait les halles tous les jeudis. Tous les deuxième mercredis du mois, une foire remplaçait le marché. Ces jours-là, l’immense champ de foire était couvert de stands, mais c’est surtout la foire aux bestiaux qui était impressionnante avec ses innombrables bêtes de somme et de boucherie, sans oublier les fameux ânes du Poitou.
Le dépaysement
Ouvriers, commerçants ou employés habitués au confort d’une petite ville, les Naboriens se trouvaient brusquement plongés en milieu rural, dans une région au mode de vie, à l’habitat, aux habitudes alimentaires et vestimentaires et même au mode d’exploitation de la terre bien différents des leurs, ce qui ne manqua pas de les dépayser. Pour certains ce dépaysement constituait un véritable déracinement, tandis que la plupart lui trouvaient bien du charme.
Les Naboriens furent surtout surpris par les habitudes alimentaires de leurs hôtes. Le légume de base du Mosellan était constitué par la pomme de terre qui accompagnait quasiment tous ses repas. Le Poitevin consommait peu de ces tubercules chers à Parmentier mais était, en revanche, très friand de haricots secs (appelés mangettes - prononcer : man’nettes - en patois poitevin). Un Naborien résume la situation de la façon suivante : à midi des man’nettes, le soir des haricots et le lendemain des fayots. La viande du cochon, que l’on grillait sur un lit de paille lorsqu’on le tuait, alors qu’à Saint-Avold on l’ébouillantait, était conservée toute l’année durant dans une jatte en terre cuite appelée “pinate”. La saumure, additionnée de salpêtre, conservait au “petit salé” sa belle couleur rose. Par ailleurs, point de jambon fumé, mais séché. Il faut reconnaître que les rillettes et pâtés de viande pouvaient rivaliser avec notre “Leberkâs” (pâté de foie). Aprés quelque appréhension, les Naboriens apprécièrent très vite le délicieux fromage de chèvre ou “chabichou” et adoptèrent l’habitude de manger un morceau de fromage à la fin des repas.
Beaucoup de Poitevins entretenaient avec amour un petit coin de vigne destiné, pour l’essentiel, à la production de vin pour la consommation familiale. A la bière dont on faisait un usage très modéré était préférée la piquette, cette boisson faiblement alcoolisée obtenue à partir de la fermentation du marc de raisin additionné d’eau et de sucre. Certes, nos réfugiés furent privés de leur choucroute traditionnelle pendant leur séjour poitevin, mais ils surent apprécier et adopter bien des spécialités gastronomiques du Poitou comme le fameux farci poitevin, les délicieuses galettes au beurre, appelées “Broyé du Poitou” et le tourteau fromager. C’est aussi de la Vienne que les Naboriennes disent avoir rapporté 1’habitude des grillades, du gigot de mouton rôti et du céleri en branches.

Les conditions morales des réfugiés
Le séjour des Mosellans dans le Haut-Poitou n’avait rien de touristique car leurs souffrances morales étaient souvent grandes. Cela tenait à de nombreuses causes. C’était en premier lieu cette brutale rupture avec ses habitudes, voire ses aises, avec sa famille et beaucoup de ses amis. Pour un grand nombre cela se traduisait par un isolement pesant. La situation de réfugié se soldait en outre par une perte de dignité à laquelle les conditions matérielles n’étaient pas étrangères.
L’évacuation avait tout dispersé : familles, amis, administrations et services. Les plus durement touchées étaient les familles de mobilisés qui mirent parfois plus d’un mois à renouer le contact par lettre avec un mari ou un fils sous les drapeaux : on imagine l’angoisse et la souffrance engendrées par cette attente. Pour ceux qui avaient perdu toute trace de membres de leur famille ou d’amis et qui s’inquiétaient de leur sort, les journaux avaient ouvert une “Suchecke” ou “Rubrique des familles dispersées”. Dans les quelques annonces de cette rubrique que nous reproduisons ci-dessous, on notera d’une part l’inquiétude qui se cache derrière certains appels et d’autre part leur date tardive, prouvant qu’on était resté pendant des mois sans nouvelles d’êtres chers :
- 5.01.1940 : Mme Schang, née Marguerite Olier, réfugiée de Saint-Avold à Saint Secondin (Vienne) recherche son frère Emile, 33 ans, invalide, qui était hospitalisé à Pont-à-Mousson le 3 septembre et qui a été transféré ailleurs.
- 21.01.1940 : Mlle Marie Banton de Lachambre recherche sa soeur qui, le 28.08.1939, est arrivée avec les malades de l’hôpital de Saint-Avold en gare d’Angoulême.
- 21.02.1940 : Victor Olier, 95 rue de la Côte à Auchel (Pas-de-Calais) recherche son frère Emile.
- 24.02.1940 : Mr Paul Pisch recherche ses frères Jean et Joseph. Adresse : Mr Paul Pisch, évacué à Champagne-Saint-Hilaire (Vienne).
- 27.02.1940 : Mr Michel Schang, entrepreneur à Saint-Avold, évacué à Ceaux-en-Couhé recherche sa soeur Mme Joseph Marion de Macheren.
Coupés de leur famille et de leurs amis et connaissances, plongés dans un environnement humain nouveau, désorientés par le bouleversement de toutes les structures familières, beaucoup se sentaient cruellement seuls. Cet isolement était encore plus durement ressenti par ceux qui, ignorant le français, devaient se contenter de communiquer par gestes avec leurs hébergeants et surtout par ceux qui habitaient maintenant dans un écart ou une ferme isolée.
Les conditions matérielles : les moyens de subsistance
L’administration préfectorale de la Vienne tâtonna assez longtemps avant de trouver la meilleure formule répondant aux besoins des réfugiés. Dans un premier temps fut appliquée à ceux-ci la disposition contenue dans la circulaire préfectorale du 27 avril 1939 qui prévoyait qu’ “afin d’éviter toute fraude, aucune allocation en deniers ne sera attribuée aux réfugiés. Ceux-ci recevront exclusivement un ravitaillement en nature”. Ce sont donc les logeurs ou les cantines qui étaient indemnisés pour les repas servis aux Mosellans. De ce fait, les situations étaient variables. Beaucoup de réfugiés prenaient leurs repas dans les familles d’accueil. D’autres - plus rares - qui disposaient de l’équipement nécessaire pour cuisiner, percevaient de leurs logeurs des produits alimentaires. Dans plusieurs localités, les Naboriens prenaient leurs repas dans des cantines ou des cafés-restaurants : c’était le cas à Brux (café), à Couhé (Hôtel-Restaurant du château), à Gençay et à Sommières (cantines).
Il va de soi que cette situation ne pouvait être que transitoire. Les raisons en étaient multiples :
- Les réfugiés qui étaient pratiquement sous la tutelle de leurs hébergeants, des dirigeants de cantines ou des restaurateurs, appréciaient fort peu cet état de dépendance et estimèrent très vite qu’ils étaient assez grands pour gérer eux-mêmes les allocations qui étaient versées.
- D’autre part, les repas qu’on servait ne correspondaient pas à leurs habitudes alimentaires.
- En outre, la plupart des réfugiés étant sans ressources et certains sans économies, la perception de l’allocation aurait permis de disposer de quelque argent pour des achats autres que pour la nourriture.
Pour toutes ces raisons, l’administration préfectorale envisagea très rapidement “de substituer… le système de l’allocation en espèces… à celui en usage (secours en nature)”. Dès que cette nouvelle disposition entra en vigueur, la très grande majorité des réfugiés délaissa progressivement la table des logeurs et les popotes pour préparer eux-mêmes leurs repas. A signaler toutefois qu’à Gencay, une popote qui fut tout d’abord municipale puis gérée exclusivement par les réfugiés continua de fonctionner, dans une ancienne salle de cinéma, jusqu’au printemps de 1940 pour environ 35 personnes. Cette popote proposait des repas conformes aux habitudes culinaires des Lorrains. Tous les mois, du reste, l’on y tuait le cochon et l’on confectionnait de la saucisse (Kochwurst), du boudin et du pâté de foie à la mode lorraine. Une autre popote, fonctionnant à Sommières-du-Clain, fut fréquentée par une trentaine de personnes jusqu’au retour en septembre 1940.
Rôle de la mairie de Saint-Avold établie à Sommières-du-Clain
La mairie de Saint-Avold fut installée à Sommières-du-Clain qui comptait en 1939 environ 900 habitants. Les conditions matérielles de cette installation étaient plus que précaires. Tout était modestement regroupé dans une salle unique; les toilettes étant inexistantes, il fallait avoir recours à celles de l’école communale. Ce fut la surprise lorsque la mairie demanda l’installation du téléphone. L’administration des P.T.T. finit par céder le seul appareil dont elle disposait encore, à savoir un téléphone de campagne américain datant de… 1917. Le seul luxe qu’on se permit fut de faire imprimer du papier à en-tête.
En l’absence de M. Eugène Hoff, le secrétaire général en titre qui était mobilisé, c’est le Maire, M. Barthélémy Crusem, secondé par trois employés qui assurait le secrétariat. La mairie disposait en outre dans la plupart des communes d’accueil d’une antenne tenue par un employé municipal chargé d’assurer la liaison entre le maire de Saint-Avold et la municipalité poitevine. Ces délégués avaient également pour mission de régler sur place les litiges qui survenaient. Rois sans terre, les maires mosellans avaient vu leurs attributions fondre comme neige au soleil. En effet, le décret du 29 novembre 1939 précisait : “les maires des communes évacuées continuent d’exercer leurs attributions, à l’exception de celles qui concernent la police générale, municipale et rurale, l’état-civil et généralement les attributions remplies en tant qu’agents de l’Etat”. Conformément à ce décret, les conseils municipaux pouvaient se réunir et délibérer valablement.
Le Conseil municipal de Saint-Avold se réunit effectivement à trois reprises à Sommières. Sur un effectif normal de 23 membres, il y avait, y compris le maire, neuf présents. Parmi les absents, il y avait quatre mobilisés (dont le premier adjoint), un malade grave (le deuxième adjoint) et neuf conseillers qui “n’étaient pas avec leur commune”. Le secrétariat de la mairie, en revanche ne manquait pas d’ouvrage. C’est à l’initiative du maire de Saint-Avold que fut créé à Couhé, dès la mi-septembre 1939 un hôpital de secours et une maternité pour les réfugiés. Le maire anticipait ainsi sur la décision du Préfet de la Vienne qui, à la suite d’accidents graves survenus lors d’accouchements à domicile, imposa dans sa circulaire du 2 janvier 1940 aux femmes réfugiées l’obligation d’accoucher dans une maternité.
Détentrice des registres d’état civil et de la population du temps de paix, la mairie délivrait les actes de naissance et de mariage, les certificats de résidence, voire de bonne vie et moeurs que sollicitaient les administrés (les naissances, mariages et décès de la période de l’évacuation étaient enregistrés dans les mairies des communes d’accueil). A cela s’ajoutait un abondant courrier administratif échangé avec les Préfectures de Poitiers et de Metz, la Sous-Préfecture de Montmorillon, les maires des communes d’accueil. Non moins important était le.courrier provenant des administrés auquel il était répondu en français ou en allemand, selon la langue utilisée dans la lettre parvenue à la mairie. Les réponses étaient toutes rédigées de la main même du maire, M. Crusem, avant d’être dactylographiées.
Une autre activité plus conjoncturelle a porté, au cours des premiers mois de l’évacuation sur la constitution d’un fichier comportant le nom et l’adresse de repli des Naboriens. Ce fichier était complété au fur et à mesure que de nouvelles adresses étaient portées à la connaissance du secrétariat. Tous les matins, la mairie prenait en charge un gros sac de courrier provenant de la poste de Poitiers et renfermant des lettres destinées à des Naboriens dont l’adresse était inconnue. Ces lettres étaient revêtues de la nouvelle adresse et réexpédiées. Après l’armistice, dès fin juin 1940, la mairie fut assaillie par une multitude de demandes de renseignements sur la date et les conditions du retour en Lorraine, formulées par les nombreux Naboriens dispersés à travers la France. Enfin, à partir de juillet 1940 mais surtout en août, le secrétariat de la mairie eut à fournir un gros travail en vue de préparer le rapatriement en Lorraine des réfugiés.
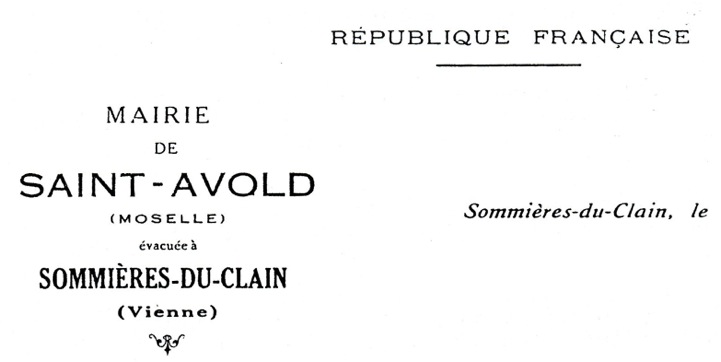 Fac-similé du papier à en-tête de la Mairie de Saint-Avold évacuée à Sommières-du-Clain.
Fac-similé du papier à en-tête de la Mairie de Saint-Avold évacuée à Sommières-du-Clain.
La scolarisation des jeunes Naboriens
La scolarisation des nombreux enfants mosellans relevant de l’enseignement primaire élémentaire et la poursuite des études dans le primaire supérieur, le secondaire et les écoles normales allaient poser quelques problèmes aussi bien aux autorités du département de la Vienne qu’aux autorités scolaires et au personnel enseignant de la Moselle.
C’est sous la direction de M. Forceville, ancien inspecteur primaire de la circonscription de Forbach que fut organisé l’enseignement élémentaire des petits Mosellans réfugiés dans la Vienne. Il n’était bien évidemment pas question d’implanter des classes de réfugiés dans toutes les localités qui avaient accueilli des Lorrains. Là où le nombre des enfants se réduisait à quelques unités, ceux-ci fréquentèrent la “laïque” du village, sur les mêmes bancs que les petits Poitevins. Ces écoles étaient désignées dans le jargon des autorités scolaires par le terme d’“écoles amalgamées”. Dans les localités où, par contre, la colonie mosellane était importante, on implanta des classes dites “spéciales”, réservées aux Mosellans. Dans ces classes, dirigées par des enseignants évacués (laïcs ou soeurs congréganistes) était maintenu le caractère confessionnel, conformément aux lois locales en vigueur dans les trois départements recouvrés. C’est ainsi que dix classes “spéciales” furent ouvertes pour les enfants de Saint-Avold : cinq à Couhé, deux à Chaunay, une à Brux, une à Gencay et une à Saint-Maurice.
Les jeunes Naboriens, élèves de l’enseignement primaire supérieur (qui assurait, en quatre années après le Certificat d’études, la préparation au Brevet Elémentaire), fréquentèrent essentiellement deux établissements scolaires qui dispensaient cet enseignement : le collège Saint Martin de Couhé et l’école primaire supérieure de Saint-Avold (E.P.S.). Le collège Saint Martin, établissement privé local, était tenu par les frères de Saint Jean-Baptiste de la Salle, dits “frères quatre bras” à cause de leur manteau avec manches sans ouvertures. Ce collège présentait l’avantage de se trouver implanté dans le secteur où les Naboriens avaient trouvé refuge et dans le bourg regroupant plus du quart de ceux-ci, ce qui explique que vingt jeunes gens de Saint-Avold le fréquentèrent au cours de l’année scolaire 1939-1940.
L’école primaire supérieure de Saint-Avold, dirigée par Mr Henry, avait ouvert ses portes début novembre 1939 à Montmorillon (Vienne). Les cuisines, le réfectoire ainsi que les dortoirs pour la centaine d’élèves garçons se trouvaient dans les locaux de l’Hôtel de l’Europe. Dans un autre bâtiment étaient installés les dortoirs pour les dix jeunes filles. Etaient admis à l’école les élèves ayant fréquenté l’établissement à Saint-Avold et ceux recrutés sur concours en juin 1939. Les élèves venaient non seulement de localités repliées mais aussi de communes mosellanes non évacuées. C’est à leur intention que fut organisé, le 20 novembre 1939, un voyage groupé au départ de Metz. Il peut paraître surprenant que des jeunes gens aient entrepris un si long déplacement pour rejoindre leur école, alors qu’ils auraient pu fréquenter un établissement scolaire resté en Moselle. La raison en est que l’E. P. S. de Saint-Avold était une école très cotée : la qualité de la préparation au concours d’entrée à l’Ecole normale attirait les jeunes de tout le département (en 1939, plus de la moitié des instituteurs de la Moselle étaient passés par l’E. P. S. de Saint-Avold).
Les jeunes qui avaient entrepris des études secondaires avaient la faculté de fréquenter les lycées de Poitiers. Dans sa circulaire du 3 novembre 1939, le Préfet fait savoir aux maires repliés que “le recteur de l’Académie de Poitiers a bien voulu envisager la création d’un internat annexe au lycée de Poitiers, susceptible de fonctionner grâce au versement du montant de l’allocation perçue par chaque élève au titre de l’assistance aux réfugiés”.